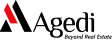Par Valeria Genesio*
Dans nos sociétés contemporaines, le compte bancaire n’est plus un simple service : il est devenu une condition de vie légale, un droit fondamental. Sans compte, impossible de percevoir un salaire, de louer un logement ou d’accéder aux services publics essentiels. C’est le seuil minimal d’accès à la vie économique et à la citoyenneté active.
L’Union européenne l’a bien compris : la directive 2014/92/UE, transposée en droit italien par le Decreto Legislativo 37/2017, reconnaît le droit à un compte courant de base pour les personnes considérées comme financièrement vulnérables. De nombreuses institutions internationales reconnaissent aussi l’accès aux services bancaires comme un droit humain émergent, en cohérence avec l’objectif 8 de l’Agenda 2030 des Nations Unies.
Mais en pratique, ce droit est souvent ignoré. Particuliers et entreprises se voient refuser ou retirer leur compte bancaire, le plus souvent sans explication claire, à cause de procédures de profilage opaques ou de mesures de compliance excessivement préventives.
Les banques disposent d’un pouvoir discrétionnaire quasi absolu, en invoquant des risques de blanchiment d’argent ou des stratégies de « de-risking ». Selon le rapport 2024/25 de l’Autorité bancaire européenne (EBA), le de-risking est aujourd’hui l’une des trois principales difficultés rencontrées par les consommateurs européens. L’EBA elle-même considère l’accès aux services financiers de base comme une condition indispensable à la participation à la vie sociale et économique.
Ce droit, pourtant inscrit dans la loi, est vidé de sa substance par des procédures de contrôle trop rigides, qui transforment une erreur de forme ou une mauvaise traduction en indice de soupçon. Une simple homonymie ou une référence sur un blog peut suffire à provoquer l’exclusion. Le tout sans contradictoire, sans justification, sans recours.
Ce paradoxe juridique appelle une réflexion urgente.
Depuis les années 1990, les banques européennes sont passées d’infrastructures publiques à réseaux d’acteurs privés. Après le 11 septembre 2001, la priorité absolue est devenue la sécurité, et la mise en œuvre des normes anti-blanchiment a été confiée à des opérateurs privés. Les banques jouent désormais un rôle de contrôle public sans être soumises aux principes de l’action publique.
Tout comme les notaires ou les intermédiaires immobiliers, elles sont chargées de mettre en œuvre les politiques contre le blanchiment, le terrorisme ou la corruption. Pourtant, elles restent des entités privées à but lucratif, sans contre-pouvoir. Le coût de cette compliance est, in fine, supporté par le citoyen.
Et bien souvent, les décisions reposent sur des bases de données payantes comme World Check, non vérifiables, alimentées par des sources peu fiables. En 2017, des autorités de protection des données de l’UE avaient émis de sévères critiques, mais depuis, rien n’a changé.
Avec l’arrivée des algorithmes, l’exclusion bancaire se fait par des signaux automatiques, souvent injustifiés. La nationalité, le secteur d’activité ou des liens indirects peuvent suffire à déclencher un refus. Et dans la plupart des cas, aucune raison n’est communiquée.
Peut-on considérer cela comme une simple décision commerciale, alors qu’il s’agit du droit de vivre dignement ?
Il est temps de repenser le lien entre accès bancaire et liberté économique. Le système actuel menace les principes de loyauté et de bonne foi.
Il faut : faire du droit au compte un droit opposable pour tous, imposer une motivation obligatoire des refus, créer des mécanismes de recours rapides, et encadrer l’utilisation des outils de profilage. Transparence, fiabilité des sources et droit de réponse doivent devenir la norme.
Personne ne devrait être exclu du système économique par un algorithme.
Avoir un compte bancaire n’est pas un privilège, c’est une condition de citoyenneté. Refuser aujourd’hui l’accès à un compte bancaire revient à exercer un pouvoir absolu sans rendre de comptes, tout en alimentant, paradoxalement, l’économie souterraine que les dispositifs anti-blanchiment visent à combattre. Et cela, aucun État fondé sur le droit ne peut l’accepter.
*Présidente d’Agedi
Dans nos sociétés contemporaines, le compte bancaire n’est plus un simple service : il est devenu une condition de vie légale, un droit fondamental. Sans compte, impossible de percevoir un salaire, de louer un logement ou d’accéder aux services publics essentiels. C’est le seuil minimal d’accès à la vie économique et à la citoyenneté active.
L’Union européenne l’a bien compris : la directive 2014/92/UE, transposée en droit italien par le Decreto Legislativo 37/2017, reconnaît le droit à un compte courant de base pour les personnes considérées comme financièrement vulnérables. De nombreuses institutions internationales reconnaissent aussi l’accès aux services bancaires comme un droit humain émergent, en cohérence avec l’objectif 8 de l’Agenda 2030 des Nations Unies.
Mais en pratique, ce droit est souvent ignoré. Particuliers et entreprises se voient refuser ou retirer leur compte bancaire, le plus souvent sans explication claire, à cause de procédures de profilage opaques ou de mesures de compliance excessivement préventives.
Les banques disposent d’un pouvoir discrétionnaire quasi absolu, en invoquant des risques de blanchiment d’argent ou des stratégies de « de-risking ». Selon le rapport 2024/25 de l’Autorité bancaire européenne (EBA), le de-risking est aujourd’hui l’une des trois principales difficultés rencontrées par les consommateurs européens. L’EBA elle-même considère l’accès aux services financiers de base comme une condition indispensable à la participation à la vie sociale et économique.
Ce droit, pourtant inscrit dans la loi, est vidé de sa substance par des procédures de contrôle trop rigides, qui transforment une erreur de forme ou une mauvaise traduction en indice de soupçon. Une simple homonymie ou une référence sur un blog peut suffire à provoquer l’exclusion. Le tout sans contradictoire, sans justification, sans recours.
Ce paradoxe juridique appelle une réflexion urgente.
Depuis les années 1990, les banques européennes sont passées d’infrastructures publiques à réseaux d’acteurs privés. Après le 11 septembre 2001, la priorité absolue est devenue la sécurité, et la mise en œuvre des normes anti-blanchiment a été confiée à des opérateurs privés. Les banques jouent désormais un rôle de contrôle public sans être soumises aux principes de l’action publique.
Tout comme les notaires ou les intermédiaires immobiliers, elles sont chargées de mettre en œuvre les politiques contre le blanchiment, le terrorisme ou la corruption. Pourtant, elles restent des entités privées à but lucratif, sans contre-pouvoir. Le coût de cette compliance est, in fine, supporté par le citoyen.
Et bien souvent, les décisions reposent sur des bases de données payantes comme World Check, non vérifiables, alimentées par des sources peu fiables. En 2017, des autorités de protection des données de l’UE avaient émis de sévères critiques, mais depuis, rien n’a changé.
Avec l’arrivée des algorithmes, l’exclusion bancaire se fait par des signaux automatiques, souvent injustifiés. La nationalité, le secteur d’activité ou des liens indirects peuvent suffire à déclencher un refus. Et dans la plupart des cas, aucune raison n’est communiquée.
Peut-on considérer cela comme une simple décision commerciale, alors qu’il s’agit du droit de vivre dignement ?
Il est temps de repenser le lien entre accès bancaire et liberté économique. Le système actuel menace les principes de loyauté et de bonne foi.
Il faut : faire du droit au compte un droit opposable pour tous, imposer une motivation obligatoire des refus, créer des mécanismes de recours rapides, et encadrer l’utilisation des outils de profilage. Transparence, fiabilité des sources et droit de réponse doivent devenir la norme.
Personne ne devrait être exclu du système économique par un algorithme.
Avoir un compte bancaire n’est pas un privilège, c’est une condition de citoyenneté. Refuser aujourd’hui l’accès à un compte bancaire revient à exercer un pouvoir absolu sans rendre de comptes, tout en alimentant, paradoxalement, l’économie souterraine que les dispositifs anti-blanchiment visent à combattre. Et cela, aucun État fondé sur le droit ne peut l’accepter.
*Présidente d’Agedi