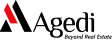La gestion des cimetières deviendra bientôt une urgence et une question de dignité humaine
par Valeria Genesio
Cher directeur, aujourd’hui, nous célébrons nos morts, mais mourir, en Italie, ne suffit plus. Et le lieu du repos éternel est devenu temporaire. Ces jours-ci, les cimetières remplis de fleurs nous renvoient l’image d’un pays encore profondément attaché à ses proches disparus. Mais ceux qui ont récemment vécu un deuil savent qu’à la douleur s’ajoute un fardeau supplémentaire : la bureaucratie nécessaire pour assurer à leurs proches un lieu digne après leur mort.
Les cimetières sont pleins, les concessions expirent, les tarifs augmentent. La question relève de la compétence des communes, chacune ayant ses propres réglementations. Les concessions funéraires ont une durée de plus en plus courte et les niches sont réattribuées, souvent à la discrétion de la commune. Dans de nombreux cas, la priorité est donnée aux résidents, comme si la mort devait respecter les frontières administratives. Ceux qui ont des proches dans une autre ville ou qui souhaitent « rentrer chez eux » après avoir vécu ailleurs doivent souvent demander la permission.
Il n’y a plus de liberté de choix. La crémation devient souvent la solution la plus pratique, non par conviction, mais par manque d’espace. Et la tombe, qui évoquait autrefois l’idée d’éternité, est aujourd’hui concédée pour vingt ou trente ans, sauf renouvellement, si la municipalité l’accepte. Elle est ensuite rouverte et, selon l’état du corps, on procède à l’exhumation ou au transfert dans une niche privée, dans un autre cimetière ou, en dernier recours, dans l’ossuaire commun, perdant ainsi tout droit sur le défunt.
L’intervention
Chaque étape a un coût : le repos éternel est devenu un contrat à durée déterminée. Et surtout, ceux qui restent ne cessent jamais de payer. Et ceux qui arrivent après paient toujours plus et pour tout le monde. Derrière cette bureaucratie minutieuse, dans laquelle il n’est pas facile de s’y retrouver, se cache cependant une question plus profonde : la perte du droit à l’inhumation en tant que partie intégrante du droit à la dignité. La réglementation est claire : les cimetières appartiennent au domaine public communal et la concession, par nature, ne confère pas un droit perpétuel.
Mais c’est précisément cette « temporalité » institutionnalisée qui marque un changement culturel. Les cimetières, autrefois lieux d’appartenance collective, sont devenus des espaces impersonnels, souvent négligés. Les allées s’effritent, les pierres tombales se décolorent, le personnel est quasi inexistant, trouver le défunt est souvent une tâche ardue. Une civilisation se mesure aussi à la manière dont elle prend soin de ses morts. Là où autrefois on prononçait des mots d’adieu, aujourd’hui on quantifie les années, les timbres fiscaux et les mètres carrés. Une pratique administrative.
Pourtant, l’idée même d’enterrement était née comme une promesse d’éternité : depuis les Égyptiens, on construisait des tombes pour qu’elles durent des millénaires, pas trente ans. Dans ce domaine également, on constate le paradoxe d’un pays qui réglemente tout, sauf ce qui compte vraiment : le lien avec le temps, la pietas romaine au sens du respect envers ceux qui nous ont précédés, la perpétuation des valeurs et des traditions familiales. Et le problème ne peut que s’aggraver : dans l’un des pays les plus âgés d’Europe, où la courbe démographique s’inverse et où l’âge moyen augmente, la gestion de la mort deviendra également une urgence. Non seulement en termes d’espace, mais aussi de sens.
*Président de l’Agedi